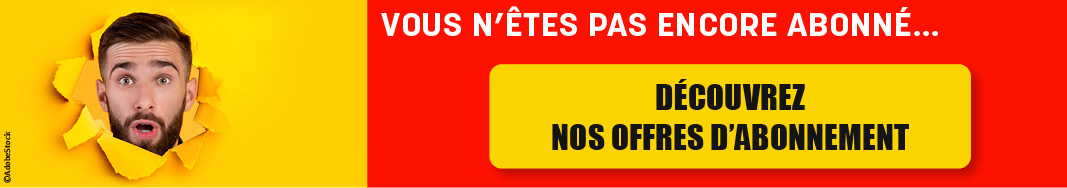Sapeur-pompier volontaire et responsable de projets à l’Idele, Joël Guillemin et parti en mission d’évaluation au Sénégal sur un programme d’accès à l’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Responsable de projets bas carbone au sein de l’Idele, Joël Guillemin est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises laitières dans leur programme de décarbonation. C’est avec une autre casquette, celle de sapeur-pompier volontaire, membre de l’organisation non gouvernementale (ONG) Pompiers solidaires, qu’il est parti en mission en novembre dernier au Sénégal. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui a vu sa population doubler en vingt ans, la priorité est l’accès à l’eau et à des installations minimales en matière d’hygiène et d’assainissement.
Quel était l’objet de votre mission d’évaluation au Sénégal ?
Joël Guillemin : « Il s’agissait d’auditer les problématiques rencontrées par la population dans différents villages prospectés et d’identifier la faisabilité d’un nouveau programme eau, hygiène, assainissement. L’association Pompiers solidaires, qui repose sur l’implication de bénévoles, intervient en effet sur plusieurs axes : le secours à des populations sinistrées en cas de catastrophes naturelles, dans le cas de conflits, d’exodes... Actuellement, il s’agit de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Des programmes de développement ont ainsi vu le jour en Bosnie, Haïti, au Pérou... D’autres sont en cours au Liban, au Bénin, au Togo, et, en 2024, la pertinence de tels programmes en Côte d’Ivoire, en Ouganda et au Sénégal a donc été évaluée. »
Était-ce votre première mission ?
J. G. : « Pour l’association, oui. J’ai postulé, car je ne connaissais pas du tout l’Afrique et que le Sénégal est un pays francophone. Même si je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions d’eau et d’assainissement, mon profil a été jugé pertinent car, dès que l’on amène l’accès à l’eau potable, derrière c’est l’agriculture – particulièrement le maraîchage – qui se développe. » Dès que l’on amène l’accès à l’eau, derrière, c’est l’agriculture qui se développe.
Comment une telle mission se prépare-t-elle ?
J. G. : « Avec les trois autres membres de l’association de la mission, nous avons pris des contacts en amont avec des interlocuteurs sénégalais pour planifier notre séjour et nos déplacements. Je me suis aussi renseigné sur les filières locales auprès du Cirad et d’étudiants sénégalais en écoles d’ingénieurs en France. Mais finalement, tout s’est organisé sur place, au jour le jour, en fonction des informations et des échanges que nous avons eus. On a pu, par exemple, rencontrer la préfète de la Région de Kaffrine, ce qui nous a ouvert des portes et donné de nombreuses pistes. Partout où nous sommes allés, nous avons pris soin de rencontrer les autorités administratives, les chefs de village, les chefs religieux pour leur expliquer notre démarche et recueillir leur assentiment. Et en aucun cas, Pompiers volontaires n’intervient à la place de l’État. »
Vu de France, on a l’image de Dakar, d’un Sénégal moderne, globalisé, ouvert sur le monde. Est-ce une autre réalité que vous avez trouvée sur place ?
J. G. : « C’est une image trompeuse car, si le quart de la population vit à et autour de Dakar, les grandes infrastructures mises en place par l’État – les routes, réseaux d’eau, d’électricité… – s’arrêtent aux centres des villages (de plusieurs milliers d’habitants) mais pas plus loin. Il faut alors se déplacer sur des pistes. Le pays affiche en outre une très forte croissance démographique qui fait que toutes les semaines, les villages qui entourent Dakar voient arriver de nouvelles familles qui s’installent comme elles le peuvent, sans que les réseaux en place soient en mesure de suivre. »
Vous avez d’abord prospecté des villages dans la zone d’expansion de Dakar, dans la zone désertique du nord-est, celle du lac rose ?
J. G. : « Oui, ça a été le premier choc. Nous avons rencontré le directeur d’une école primaire couplée à un collège qui accueille au total 1 156 élèves, avec 106 élèves dans la classe la plus chargée, le CE1. Il n’y avait que deux seuls points d’eau (non analysés) et huit sanitaires pour l’ensemble des enfants et des enseignants. Notre objectif était de voir s’il était possible de contribuer au financement de l’extension du réseau d’eau et à l’installation de toilettes supplémentaires, en faisant travailler des entreprises locales. On a commencé à recueillir quelques devis et de retour en France, nous avons monté un dossier de demande de financement auprès des agences de l’eau1, partenaires de Pompiers solidaires sur ces programmes. »
Quelles sont les spécificités de ce secteur ?
J. G. : « Dans ce secteur très plat, l’élévation du niveau de l’océan fait que dès que l’on creuse, on tombe sur de l’eau salée, qui remonte de plus en plus dans les terres. Dans une autre zone de delta, on assiste même à une inversion des courants, et des villages sont inondés en permanence, soit par l’eau salée qui remonte, soit par l’eau douce lors de la saison des pluies, avec des problèmes de moustiques. Dans le troisième village de ce secteur que nous avons visité, N’Dangane, au bord du littoral, tout est mangé par le sel : les tôles, le tableau de l’école… Impossible dans ces conditions de faire des forages. C’est ce qui nous a poussés à aller ensuite dans le centre du pays, à la limite avec la Gambie, une zone semi-aride plus agréable. »
Et quels sont les besoins des villageois ?
J. G. : « Ces villages de brousse nous ont été indiqués par la préfecture de Région de Kaffrine, mais ils ne sont pas répertoriés sur les cartes, nous avons donc été accompagnés par un guide interprète. Ce sont des villages en terres cuites, aux toits en végétaux avec toujours un arbre au centre du village où tout le monde se rassemble. Des villages sans électricité, avec de l’eau issue de puits aménagés dans les années 1970, mais qu’il faut creuser de plus en plus profond (jusqu’à 86 mètres pour certains) pour en retirer, à la traction manuelle, de l’eau, non potable. Dans l’un de ces villages, le puits était à sec depuis plusieurs mois et les habitants devaient quémander de l’eau au village d’à côté. Malgré tout, on y a été accueillis avec le sourire et des paquets d’arachides, la culture locale. Quant aux sanitaires, parfois ils se résumaient à un trou au milieu de pneus, sans évacuation ni papier WC, et avec un système rudimentaire de lavage des mains ; un tuyau d’eau d’où on fait couler un maigre filet car il faut économiser l’eau. Ailleurs, c’était le plus souvent des dalles fosses. »
Qu’est-il prévu pour ces villages et avec quel suivi ?
J. G. : « Un programme est prévu sur plusieurs années avec des forages à renforcer, des toilettes à installer, et un accompagnement à l’hygiène, le tout en s’appuyant sur l’existant. L’unité de secours et d’intervention de l’association va suivre les chantiers et, dans les trois à quatre ans, une nouvelle mission se rendra sur place pour faire un point et réajuster si nécessaire. Le but est de transférer aux autorités locales et villageoises les investissements réalisés afin qu’ils les gèrent à l’avenir ; d’où l’importance de trouver des référents dans chacun de ces villages et de la formation à la maintenance de ces installations. Le souhait localement est de commencer ces programmes par les écoles, ce qui nous va très bien, car c’est un très bon levier de sensibilisation. »
Propos recueillis par Patricia Olivieri
1. Agences de l’eau Loire Bretagne, Adour Garonne mais aussi financements de Régions, Départements de l’ouest de la France et de mécènes privés.