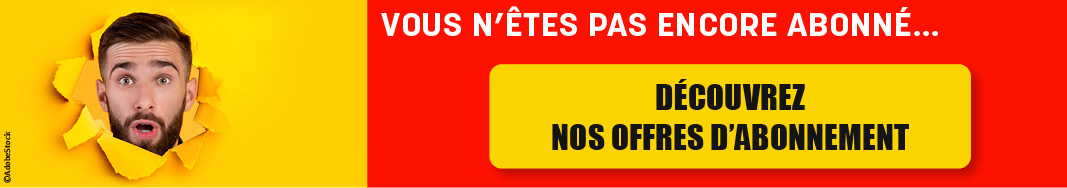PRODUCTIONS ANIMALES
Il est temps de ré-enchanter l’élevage

Comment définir l’élevage durable ? Question épineuse pour Jean-Louis Peyraud de la direction scientifique agriculture de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). Lors de la conférence organisée par la chambre régionale d’agriculture mi-octobre, il a préféré définir sa vision de l’élevage de demain dans des systèmes alimentaires durables. « On parle certes élevage, mais il fait partie de l’agriculture qui est faite pour nourrir les Hommes. » Dans ce cadre, la notion de souveraineté alimentaire prend tout son sens et, à court terme, celle de la France en produits carnés et laitiers est en péril. « Au niveau de l’élevage français, nous sommes dans une phase de transition forte. Depuis 2016, nous avons perdu un peu plus de 800 000 vaches laitières et allaitantes en France. Aujourd’hui, nous avons une population de bovins presque identique à celle de 1860. Dans le même temps, le nombre d’habitants a quelque peu augmenté. En 1860, chaque Français était suivi par 0,2 vache, aujourd’hui par moins de 0,1. » Ainsi, la production laitière qui s’était jusqu’alors maintenue, du fait d’une augmentation de la production par vache, diminue depuis deux à trois ans comme l’abattage des gros bovins. La tendance est identique en porcs.
En 2002, la France comptait un peu plus de 15 millions de truies selon l’Institut de l’élevage contre 12 millions en 2022. « Cela a été compensé par davantage de prolificité au départ, mais aujourd’hui la Bretagne enregistre une diminution de 5 % de porcs. C’était - 2 % l’année d’avant », commente l’expert scientifique. Seule la filière œuf tire son épingle du jeu. Conséquence : « Nous risquons de ne plus être autosuffisants ni en lait, ni en viande à horizon 2030. Ce phénomène est général en Europe à l’exception de certains pays comme l’Irlande ».
Des enjeux de taille
Sur le plan économique aussi, des choses interpellent, notamment pour la filière bovins viande. Preuve en est : entre 1990 et 2015, les données du Rica révèlent que la productivité numérique de la filière bovine allaitante du grand Massif central a légèrement diminué quand la part de concentré par UGB a augmenté. Par ailleurs, de plus en plus d’énergie non renouvelable est utilisée et la capitalisation par unité de travail (UTH) a presque doublé. Pendant ce temps-là, la valeur ajoutée ne cesse de diminuer. Cela soulève des questions selon Jean-Louis Peyraud. « Il s’agit d’une filière où les soutiens financiers sont élevés. Si la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) a été très intéressante lors de sa mise en place, cette prime a des effets un peu pervers. Elle bloque, en effet, les réorientations, incite à des investissements et est captée par l’aval. Par ailleurs, et c’est là davantage une vision de chercheur, il est bon de
s’interroger si demain il faudra encore primer des animaux qui sont dits par ailleurs polluants car ils émettent du méthane. Je vous le dis car cette question pourrait rapidement être posée. » Une position sciemment provocatrice qui s’inscrit dans un contexte environnemental et politique beaucoup plus global. « Quand on voit cela, il est légitime de se poser la question en quoi l’élevage bovin contribue au réchauffement climatique sachant que le méthane est un gaz à courte durée de vie. L’élevage français va être en effet touché par les agendas politiques, car aujourd’hui nous ne parlons plus que du réchauffement climatique », poursuit Jean-Louis Peyraud. Si, selon lui, le réchauffement climatique vient d’ailleurs et que « nous sommes passés entre 1860 et aujourd’hui de 0 à 0,6 voiture par habitant », l’agriculture va être soumise à des impacts très forts des décisions politiques.
Un outil inadapté à l’agriculture
Force est de constater que l’agriculture peine à faire baisser ses émissions quand l’industrie les a divisées presque par deux. « L’agriculture représente 20 % des émissions nationales et l’élevage 12 %. L’industrie émet aujourd’hui, en tout cas selon la méthode de calcul actuelle, moins de GES que l’élevage. Dans quinze ans, si l’élevage ne diminue pas ses émissions, il sera le plus gros émetteur de France. On va lui tirer à boulet rouge dessus. Il faut anticiper ce phénomène » , insiste le chercheur. Surtout, il est important de dire ce que l’élevage « fait bien. Mais nous n’avons pas d’outil pour cela. L’analyse du cycle de vie, qui est l’outil utilisé aujourd’hui, décrypte tout ce qui est fait de mal. Il a été imaginé pour l’industrie. Tous les scénarios prospectifs s’inspirent de l’analyse du cycle de vie et aucun ne prend en compte les progrès techniques de l’élevage. » Le constat dressé, il reste à définir les voies de progrès de l’élevage, et il est surtout urgent pour Jean-Louis Peyraud de trouver les leviers pour « ré-enchanter l’élevage. Il faut retourner la chaussette ».
L’élevage reconnecté
« Avant nous avions une approche très linéaire des systèmes : ressources – produits – déchets. Toutefois, cette vision a conduit à découpler en partie l’animal du végétal. Dans l’esprit populaire, il a été oublié que l’élevage reconnecte l’agriculture et le sol en produisant quelque chose. Il faut se rappeler que le sol est la base. L’élevage reconnecte en recyclant des biomasses non consommables par l’Homme. Il produit des engrais organiques naturels, non plus des déchets. Demain, avec un coût de l’énergie très fort, nous serons contents de retrouver les effluents d’élevage en lieu et place de l’ammonitrate. Il facilite la diversification des rotations et enfin il produit des services écosystémiques », argumente-t-il. Ainsi, sur le plan des ressources, la première des choses à retenir est que plus de la moitié des aliments consommés en élevage sont des fourrages (pâturage ou herbe conservée). « 50 à 95 % des protéines utilisées en élevage ne sont pas consommables par l’Homme. Par ailleurs, pour contrer cette compétition qui existe entre alimentation animale et humaine, il est opportun de monter la quantité de protéines produites par kilogramme de protéines végétales consommables par l’Homme, mais utilisées en alimentation animale. Par exemple, la vache laitière peut en produire 1 à 2 kg. Les ruminants sont donc efficients à condition qu’ils mangent du fourrage », poursuit le chercheur. Autre point : développer des rotations et des assolements avec davantage de légumineuses. « Cela présente des avantages multiples : davantage d’autonomie protéique pour l’élevage, une maîtrise des bioagresseurs et moins de pesticides, des aliments locaux… Finalement, l’animal est le tampon de toutes les variations des filières végétales. »
L’atout prairie
Enfin, la prairie apparaît comme un atout pour la biodiversité : diversification des espèces, pollinisateurs, diversification de l’usage des terres et le maintien des habitats ouverts. La prairie est également un garant de la santé des sols. « Il y a davantage de carbone stocké dans les sols grâce aux prairies (+ 0,25). Elle limite également l’érosion des sols. Il y a enfin beaucoup plus d’invertébrés », souligne Jean-Louis Peyraud. Enfin, la prairie a d’autres rôles. « Elle travaille à la régulation des flux nitrates et des flux d’eau. On maintiendra, en effet, les zones humides car il y a des ruminants pour les entretenir. La prairie engendre également une réduction des pesticides » , insiste-t-il. Sans oublier son rôle primordial dans le paysage rural. Le ré-enchantement de l’élevage est à portée de main encore faut-il que tous s’en saisissent.
Marie-Cécile Seigle-Buyat
Les effluents d’élevage pour baisser le coût carbone
Les effluents d’élevage aujourd’hui sont un engrais qui ne coûte rien alors que l’ammonitrate coûte très cher à synthétiser. À chaque fois que l’on pourra utiliser des effluents liquides à la place d’un engrais minéral, on baissera le coût carbone de l’agriculture. Toutefois, beaucoup d’azote est perdu, volatilisé par l’ammoniac. Des techniques existent pour réduire ces émissions d’ammoniac : le pâturage pour les ruminants qui permettent un recyclage direct et une régulation des flux d’azote, la couverture des fosses, l’enfouissement rapide après épandage, éviter les mélanges d’urine et des fèces…